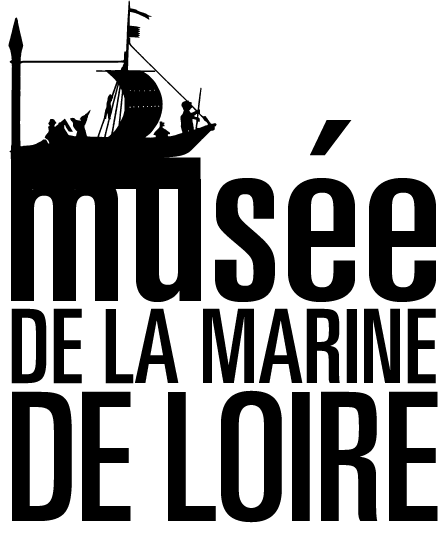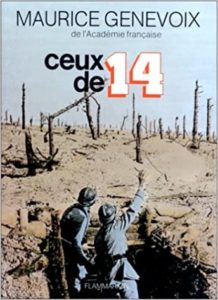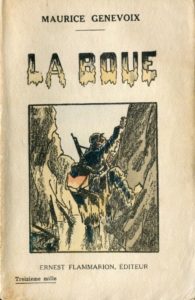Circuit Maurice Genevoix
En 1919, le gouvernement décide d’ériger des monuments en hommage aux morts de la Grande Guerre. Des souscriptions publiques, des subventions, des emprunts vont permettre de les financer.
Œuvre de monsieur Masson, architecte à Orléans, le monument aux morts de Châteauneuf-sur-Loire est inauguré en 1922 place d’Armes (aujourd’hui place Aristide Briand).
Ce qu’il a vécu aux Éparges a profondément marqué Maurice Genevoix qui y a combattu en 1915 et y fut grièvement blessé le 25 avril 1915. En effet, ce village de la Meuse, dominé par une colline stratégique, fut, pendant plusieurs mois, le théâtre de combats acharnés et sanglants.
C’est là qu’en février 1915 mourut son ami Porchon, son « frère de sang ».
Le 25 avril 1915, trois balles le blessent très grièvement. Évacué, Maurice Genevoix sera réformé après sept mois de soins dans différents hôpitaux, ayant perdu la mobilité du bras et de la main gauche.
Grâce à l’intervention de Paul Dupuy, secrétaire de l’École normale supérieure, avec qui Maurice Genevoix a entretenu une correspondance pendant la guerre et à qui il a envoyé ses carnets de guerre, le contrat d’édition est signé avec Hachette pour un « livre qui n’existe pas », qu’il reste à écrire.
Il écrit alors plusieurs ouvrages, sous forme d’un journal de guerre : Sous Verdun en 1916, Nuits de guerre en 1917, Au seuil des guitounes en 1919, La boue en 1921, Les Éparges en 1923.
En 1949, il décide de les rassembler en un seul volume, Ceux de 14. Cet ouvrage paraîtra sous le titre Ceux de 14 en quatre parties : Sous Verdun, Nuits de guerre, La Boue, Les Éparges.
Après la seconde guerre mondiale, Maurice Genevoix devient le porte-parole des anciens poilus et œuvre pour la fondation du Mémorial de Verdun. Le 17 septembre 1967, il en prononce le discours inaugural.
Voici donc [le] Mémorial, celui des morts et celui des vivants, désormais inséparables. Il était bien que non loin de l’Ossuaire où gisent tant de morts confondus, les pèlerins de Verdun puissent parcourir ici même, sur un des lieux de leur long sacrifice…
Ce Mémorial, pour vous, les Anciens, c’est aussi cela, n’est-il pas vrai ? Tout homme, au long de son existence, lorsqu’il regarde autour de soi, devrait pouvoir dénombrer sur sa route les compagnons de sa jeunesse, avec lui mûrissant, vieillissant. C’est une des joies de la vie ici-bas, normales et bonnes. Nous autres, à peine sortis de l’adolescence, quand nous nous retournions ainsi, nous ne voyions que des fantômes. Mutilés dans notre corps, mutilés dans nos amitiés. Voilà la guerre. Désormais, derrière nous, il y aura ce Mémorial. Il est aussi, il est encore cela : il nous rend, avec notre passé commun, nos camarades toujours vivants…
Quel vivant n’en aurait besoin, en ces temps toujours incertains ? Puisse la lumière qui va veiller ici les guider enfin, vers la Paix !
Maurice Genevoix, « le plus grand peintre de cette guerre » d’après Jean Norton Cru.
Le jugement de Jean Norton Cru, lui-même ancien combattant, a d’autant plus de poids qu’il s’appuie sur l’étude de trois cents témoignages dans Témoins, ouvrage paru en 1929, réédité par les Presses universitaires de Nancy en 1993.
Dans son œuvre de guerre, Genevoix a révélé une conscience, une aptitude, un talent, je voudrais ajouter un génie, mais le mot ferait sourire, qui constituent un cas unique non seulement dans notre guerre, mais dans toute notre histoire.
… Quelles sont donc ces qualités du narrateur que je n’ai pas craint d’appeler le génie de Genevoix ?
Il a su raconter sa campagne de huit mois avec la plus scrupuleuse exactitude, en s’interdisant tout enjolivement dû à l’imagination, mais cependant en ressuscitant la vie des événements et des personnes, des âmes et des opinions, des gestes et des attitudes, des paroles et des conversations.
… Genevoix est doué d’une mémoire auditive qui lui a permis de retrouver les mots typiques de chaque individu, son accent, sa manière de discuter, tout son tempérament enfin qui se faisait jour dans ses paroles. Aucun écrivain de l’avant ou de l’arrière n’a su faire parler les poilus avec un réalisme d’aussi bon aloi qui ne les idéalise pas plus qu’il ne les avilit.
… L’avenir se demandera par quelle aberration la génération qui a vu la guerre de 1914 n’a pas su distinguer dans son sein le plus grand peintre de cette guerre.
Les mots de Maurice Genevoix :
Il m’a été reproché quelquefois d’« abuser » du pathétique. J’accepte le reproche, mais je plaide l’innocence : je suis devenu ainsi ; c’est bien un survivant qui a écrit mes livres, qui trace en cet instant ces lignes. Et voici maintenant un aveu : si j’avais le pouvoir de faire qu’il en soit autrement, je refuserais de l’exercer.
(Trente mille jours de Maurice Genevoix, © La Table Ronde, 2019)
Dans ma chambre sous le toit à Paris, dans ma chambre sur les Petits Sentiers, à Châteauneuf, j’ai rédigé mes
trois premiers livres de guerre. Ai-je eu à « m’interdire », comme l’ont écrit certains commentateurs, « toute affabulation, toute recherche de l’effet » ? Même pas. J’allais, de jour en jour, de page en page, dans une entière soumission à la réalité vécue, avec la volonté constante d’être véridique et fidèle… Je me souviens de mes deux chambres, de l’enveloppement de leurs deux solitudes, des bruits à demi entendus qui traversaient leurs deux silences, à Paris la pluie du jet d’eau, les quarts d’heure que sonnait l’horloge, à Châteauneuf un surgeon de la Loire, le long cri d’un courlis à travers le ciel nocturne.
…J’écrivais, je tentais d’exprimer, soutenu dans mon dur et passionnant effort par le sentiment contrasté, pathétiquement et bellement vivant, de tout ce qui m’était rendu. Et cela m’acheminait – je ne l’ai su que peu à peu, mais j’en suis sûr, si sûr aujourd’hui – vers ce qui allait devenir, peut-être, au long de mon long cheminement, la raison d’être de toute une œuvre et sa justification.
(Trente mille jours de Maurice Genevoix, © La Table Ronde, 2019)
Sous Verdun, qui paraît en 1916, alors que la bataille de Verdun fait rage, sonne si vrai qu’il n’échappe pas à la censure.
Lorsque j’ai publié mon premier livre, « Sous Verdun », il y a de cela soixante-quatre ans, rares, très rares étaient les « livres de guerre » antérieurement parus. Le grand succès, consacré par le Goncourt, était allé d’emblée au « roman » de René Benjamin, « Gaspard », plein de talent, mais dont l’aimable verve et l’ignorance flagrante des réalités du combat, en donnant de la guerre une image fantaisiste et fausse, avaient abusé l’opinion. Pas une ligne n’en avait été censurée. « Sous Verdun » le fut largement, par pages entières ; et cela fut, et cela est resté à mes yeux un signe et un encouragement. Ni l’arbitraire, ni la bêtise n’ont le goût de la vérité. Et non plus l’habitude d’un confort intellectuel qui regimbe dès qu’on le bouscule. La critique, à l’époque, n’en a pas moins perçu d’emblée la loyauté de mon témoignage et senti qu’il « sonnait vrai ». Certains blancs me donnaient à sourire : il importait peu, à mes yeux, que le bœuf de conserve, le « singe » allemand, « moins sec, je l’avais dit, et moins épicé que le nôtre », eût été caviardé de ce fait par un censeur patriote. Avais-je eu tort d’écrire, pour l’avoir vu, que dans le fort et la confusion d’une bataille les fantassins, fussent-ils français, tiraient précipitamment au lieu de viser à loisir ? […] Mais dans l’ensemble, j’ai été cru et j’en ai été heureux.
(Trente mille jours de Maurice Genevoix, © La Table Ronde, 2019)