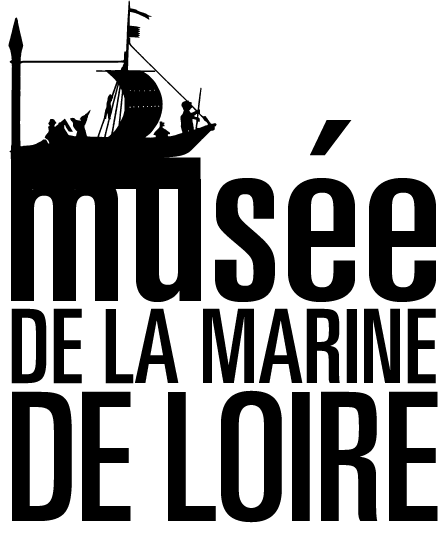Circuit Maurice Genevoix
Le premier marché couvert, la Vieille Halle, ancien hangar à bateaux de Châtillon-sur-Loire, a été installé dès 1854. Puis ce fut la halle aux veaux (1875) qui a disparu. Enfin, la Nouvelle Halle, construite en 1903, destinée à abriter les vendeuses de « menues denrées » : volailles, lapins, beurre, œufs, etc. qui, auparavant, étaient alignées sur les trottoirs de la Grande-Rue, exposées aux intempéries.
Les mots de Maurice Genevoix :
Le marché du vendredi.
Je m’étais proposé de dépeindre… ce déferlement des blouses, cette bruyante invasion terrienne qu’était naguère, pour ma petite ville, le marché du vendredi… Les trottoirs de toute la Grand’Rue, du château à la Croix-de-Pierre, débordaient sur la chaussée. Deux trottoirs sur un kilomètre, sans parler de la halle aux grains, aux porcelets, du champ de foire où trottaient, tenus à bout de longe par les valets des maquignons, les percherons à la queue tressée de paille. Des flaques, des mares, des étangs de légumes, de volailles, de lapins, de beurre, de fromages, d’œufs croulants, de chevreaux à la saison.
(Au cadran de mon clocher de Maurice Genevoix, © Plon, un département de Place des éditeurs, 1960)

La vieille halle, ancien hangar à bateaux, un jour de marché ; carte postale ancienne ; collection particulière
Une cure de sociabilité.
Pour ces gens-là, côté Berry, pour leurs voisins du Val de Loire, pour les Gaulois de la rive droite, le marché du vendredi, en même temps qu’un marché en effet, des plus actifs et des plus animés, était une fête, une cure de sociabilité, une réjouissance. Notre maison avoisinait un carrefour. Bordant la rue qui monte du pont, du sud au nord, elle était à vingt pas de la route nationale est-ouest. De sept heures du matin à la nuit, le flot des voitures montant, descendant ne cessait pratiquement pas. Torrentueux, bruyant, hennissant, aboyant. Car les voitures à chien abondaient, voitures pour femmes seules d’ordinaire…
(Au cadran de mon clocher de Maurice Genevoix, © Plon, un département de Place des éditeurs, 1960)
On dételait dans les cours, chez le charron, chez le maréchal, chez le charcutier aubergiste. Les carrioles tombaient sur leurs brancards, chaque cheval avait sa « case », un box de planches appuyé contre un mur, un anneau scellé pour le licol. Des alignements de cases, des mines de crottin, où chacun, l’heure du retour venue, savait retrouver sa bête.
Mais avant, on avait fait son plein : de cordialité, de manille, de billard, de fumée, de paroles. « On déjeune, gars ? – On déjeune… » On s’attablait à dix, à vingt, dans l’arrière-salle du charcutier. Deux sous de pain, du pain blanc, du pain tendre ; deux boulettes de viande en sauce, à deux sous l’une ; le quart d’un fromage à huit sous ; trois sous pour une chopine de rouge. Faites le compte : il y en avait pour onze sous. Mais on s’en pourléchait encore, on s’en congratulait jusqu’au milieu de la chaussée, entre les roues des premières voitures réattelées pour le retour : « Bon d’là ! On a bien déjeuné ! »
(Au cadran de mon clocher de Maurice Genevoix, © Plon, un département de Place des éditeurs, 1960)